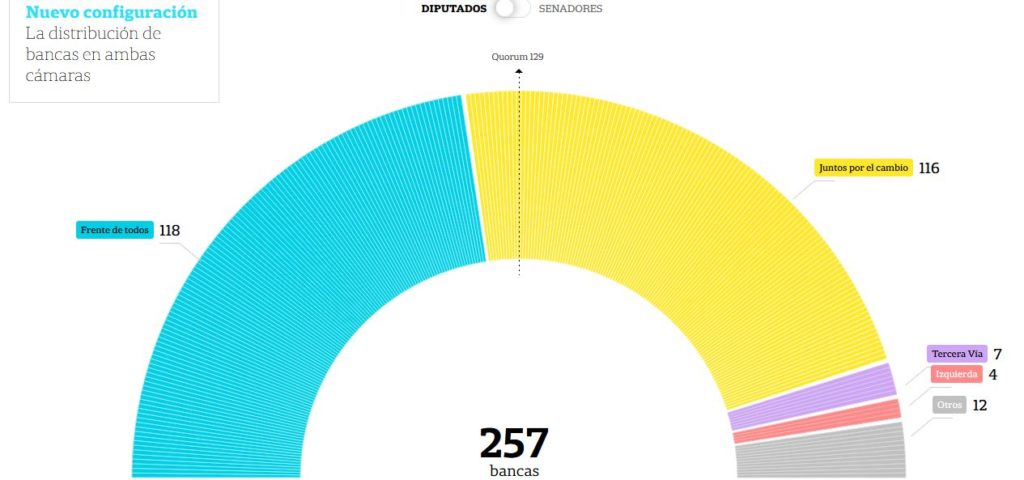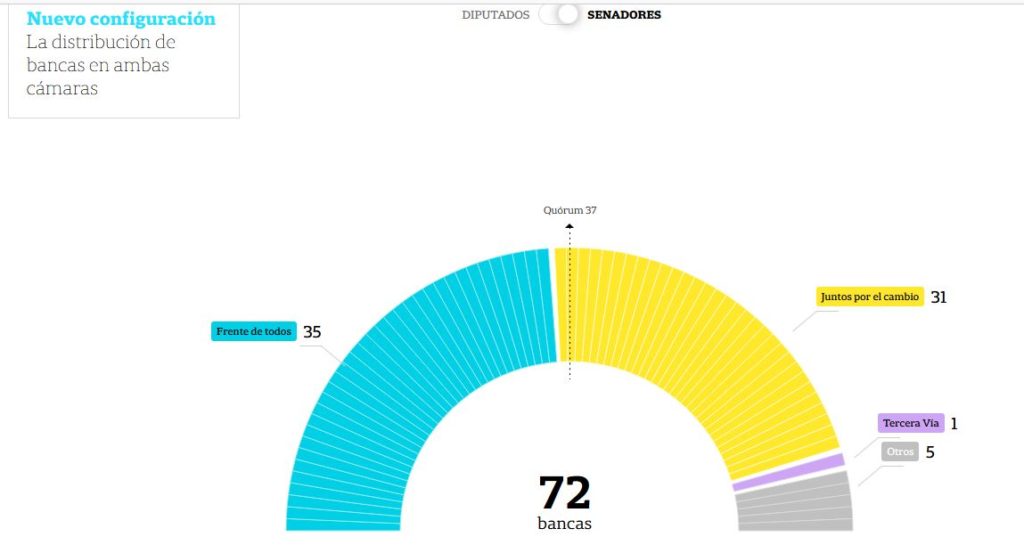I. DESCUBRIENDO EL INCA
Desde mis más remotos recuerdos, siempre me fascinaron las civilizaciones precolombinas, y en particular la de los incas.
Entonces no tenía consciencia de que se trataba de la civilización más emblemática de la historia de América Latina, a pesar de la brevedad de su resplandor (desde el principio del siglo XIII hasta la llegada de los guerreros del general Pizarro en 1532).
Adolescente soñaba con las orillas del lago Titicaca, sitio donde leyendas y relatos se acuerdan para situar el origen de la civilización inca; con la entonces capital Cuzco, el “ombligo del mundo”, y el valle sagrado donde se halla la famosa ciudad del Machu Picchu.
Sólo años más tarde, cuando descubrí de verdad el Puente del Inca, puente natural sobre el río Las cuevas, en la carretera que une la ciudad de Mendoza a la frontera con Chile, volví a interesarme en la civilización inca así como en su importancia en Argentina, tan lejos de su cuña original.
La presencia de los incas en la Argentina la certifican los vestigios de vías y estructuras que quedan del reino de Pachacutec, y que conocemos bajo el nombre de Qhapaq Ñan, o sea “Carretera real” en idioma quechua, una red que permitía viajar rápidamente desde el norte hasta el sur del imperio.
Esta carretera de más de 6000 kilómetros unía la capital Cuzco con la ciudad de Pasto en Colombia hacia el norte, y con el piedemonte andino del Aconcagua en su parte sur, cruzando Ecuador, Perú y Bolivia. Este “Camino mayor andino” lo completaba una amplia red segundaria de 40 000 kilómetros utilizando las infraestructuras pre incaicas existentes de cada lado de los Andes, hasta Santiago de Chile en su parte oeste.

Esta red de carreteras pavimentada, con escaleras talladas en la roca misma, puentes suspendidos cruzando valles encajonados y mesetas desiertas, la mayoría hallándose entre 3000 y 5000 metros de altitud, unía los centros administrativos de las zonas donde vivían los pueblos sometidos por los incas, las zonas agrícolas y mineras así como varios templos. Un sistema de “chasqui wasi” (posadas), “pukara” (fortificaciones) y “tambo” (tabernas) completaba ese conjunto con el cual el Inca podía controlar todo el Imperio. La utilizaban los “chaquis”, servidores del Inca, encargados de transportar el correo oficial hasta los límites de su territorio.
Se considera que Diego de Almagro, el conquistador del Perú, fue el primero en recorrer el “Camino del Inca”, cuando se fue a explorar y conquistar territorios más al sur, en 1535, en lo que volvería Argentina años más tarde; la crónica del viaje de ese conquistador, contemporáneo de la culminación de la presencia inca en Argentina, constituye un precioso testimonio todavía considerado por los historiadores.
Más allá de las fronteras modernas, el Qhapaq Ñan representa un vínculo entre las varias culturas andinas. Por lo que los gobiernos de los 6 países interesados en el tema lograron en 2014 la inclusión del Qhapaq Ñan en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

II. CAMINANDO POR EL QHAPAQ ÑAN
El Qhapaq Ñan cruza siete provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Ese camino ya existía desde 2000 años cuando los incas lo “modernizaron”. La UNESCO incluyó en su lista 13 tramos del camino, o sea unos 120 kilómetros a lo largo de los cuales se pueden encontrar 32 sitios arqueológicos.
Partiendo desde la frontera de Bolivia, vemos que el Qhapaq Ñan cruza la provincia de Jujuy por la Quebrada de Humahuaca. El pueblo de Tilcara, con su fortaleza (pucará), fue fundado por los indios tilcaras. Constituye una perfecta ilustración de cómo los incas aprovecharon las infraestructuras existentes para hacer del pueblo una ciudad de suma importancia.
Avanzando hacia el sur los incas cruzaron lo que se llama hoy la provincia de Salta hasta el pueblo de Cafayate, pasando por el puerto Abra del Acay, el más alto del Qhapaq Ñan, de 4895 metros de altura, y bajando hasta los valles Calchaquies. Ese puerto situado sobre la Ruta 40 sigue todavía uno de los más altos del mundo, con excepción de unos puertos asiáticos.
A lo largo de ese trayecto podemos encontrar también – esta lista no pretende a la exhaustividad – las ruinas de Tastil, el sitio de Graneros de la Poma, o el del Potrero de Payogasta. Cerca de Cachi, el sitio arqueológico de La Paya presenta vestigios de una importante ciudad inca, sede del poder imperial representado por un funcionario de alto rango, “El Inca Curaca”.
En Salta, se dice del MAAM (Museo de arqueología de alta montaña) que es el mejor museo de Argentina en lo que se refiere a la cultura inca. Allí se pueden ver momias de niños sacrificados siguiendo los rituales incas, y descubiertas en 1999 en las cercanías del Pico Llullaillaco, un volcán culminando a 6739 de altura, el santuario sagrado más alto del imperio inca.
El Qhapaq Ñan llega hasta la ciudad sagrada de Quilmes en la provincia de Tucumán. Los indios Quilmes sobrevivieron a la convivencia con los incas, pero fueron derrotados por los conquistadores españoles. Desde 2007 ese sitio quedará para nosotros un “rendez-vous manqué”, una ocasión de descubrirlo perdida por una huelga de los indios Quilmes que reclamaban la gestión propia del sitio. Un conflicto que empezó en 1977. En la época las autoridades provinciales expropiaron a los miembros de la comunidad y luego en 1992 concedieron el sitio a un hombre de negocio, para un periodo de 10 años. Luego los Quilmes fueron a juicio para impedir la prórroga de esta concesión. Ganaron, pero tuvieron que bloquear la entrada al sitio para obtener por fin el derecho a gestionarlo ellos mismos. Ahora se puede visitar lo que se llama desde esa victoria india “El complejo de las ruinas de Quilmes”.

Otro sitio inca notable en la provincia de Tucumán es la Ciudadita, también llamada Ciudad vieja, situada en el parque nacional Aconquija, a unos 4400 metros de altura.
Más allá entramos en la provincia de Catamarca para recorrer un trozo de 1 kilómetro sobre el Qhapaq Ñan, entre el Pucará de Aconquija y el sitio arqueológico de El Bajo, lo cual también entra en la lista de la UNESCO, gracias a su perfecto estado de conservación.
Al noroeste de la ciudad de Londres en esta misma provincia encontramos las ruinas del Shincal de Quimivil. Previo a la invasión de los incas, este sitio tomó cierta importancia después de su llegada. Situado en una junción de carreteras sobre el Qhapaq Ñan, se considera uno de los más importantes centros administrativos del imperio inca en Argentina.
Paralelamente a la ruta 40, el Qhapaq Ñan sigue hacia el sur hasta la Tambería del inca en Chilecito, provincia de La Rioja, un sitio desgraciadamente bastante degradado. Cruza la Cuesta de Miranda, y luego penetra en la provincia de San Juan.
En esta provincia, el camino del inca sigue hacia Barreal, cruza el Parque de El Leoncito y sus sitios incas, para luego penetrar en la provincia de Mendoza. Acá el Qhapaq Ñan pasa por el valle de Uspallata donde podemos ver las ruinas de Ranchillos y las de Tambillitos.
III. REALIDAD Y LEYENDA: EL PUENTE DEL INCA
Situado en el límite meridional del imperio inca, el Puente del Inca constituye una rareza geológica que viene recordar la presencia de ese pueblo en el suelo argentino.

Como suele ocurrir a menudo cuando faltan los documentos escritos, Historia y leyendas se confunden, y las leyendas muchas veces vuelven a volverse Historia.
Por ejemplo esa que cuenta como el heredero del Inca cayó muy enfermo y se dijo que sólo le podían curar unas aguas provenientes de una fuente situada en los extremos del imperio. Así se fue con su séquito, pero al llegar frente al río que los separaba de esa fuente mágica, no pudieron pasar. Entonces los soldados formaron un puente humano, lo cual por voluntad divina se petrificó y así se pudo salvar el príncipe.
Otra leyenda cuenta como fue el Inca mismo quien necesitó de hierbas medicinales que sólo crecían en el límite sur del imperio. El se salvó mediante el puente de piedra construido en una noche por Inti, el dios del sol, y Mama Quilla, la luna, y que le facilitó el cruce del río bajando del cerro.
Pese a que la civilización de los incas no marcó mucho tiempo la historia de la Argentina (entre 1479 y 1534), queda notable que en su frontera con Bolivia, hasta el Aconcagua, la ruta 40, uno de los mayores ejes viales del país, sigue más o menos exactamente el antiguo camino del Inca, el Qhapaq Ñan.
Otra anécdota más o menos histórica es la leyenda de la creación de la bandera argentina. Se dice que la creó el general Belgrano en la ciudad de Rosario en 1812, a partir de los colores del cielo, celeste y blanco, y que se añadió el sol que figura en el centro para recordar al dios inca Inti. La bandera la validó de manera oficial el Congreso de la Nación el 25 de julio de 1816, unos días después de la declaración de la Independencia (9 de julio).

¡Hasta se dice que en esta oportunidad el general propuso designar a un descendiente del Inca a la cabeza de la nueva monarquía constitucional!
Sin embargo entre realidad y leyendas, ¡todavía nos queda un montón de misterios que aclarar a lo largo de este famoso y tan lindo camino del Inca!
*
Para completar, un interesante artículo del diario Clarín, sobre las ruinas del Shincal de Quimivil.
Así como ese documental video de Laura Carbonari. (Duración 19’39)