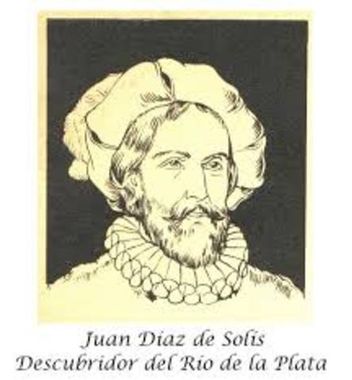Steppe en Patagonie — Photo Claudio Daniel Muro — Domaine public — CC
A l’arrivée des Espagnols, à la fin du XVème siècle, on comptait environ 2 millions d’autochtones en Amérique du sud, pour la plupart venus d’Asie et d’Océanie au fil du temps, par le détroit de Bering et l’Amérique du nord.
Les Espagnols ont toujours entretenu des relations plutôt violentes avec ces populations, se considérant un devoir de civilisateurs venus les sortir de leur état de “barbares”. Les conquistadores s’étaient donc fixé trois missions essentielles : soumettre, assimiler, évangéliser. D’où la grande importance des militaires et des représentants de l’Église dans le processus de conquête, qui, face aux résistances des indiens, s’est rapidement transformé en processus d’extermination de la grande majorité des populations, et de la négation des droits des survivants, considérés comme infrahumains.
La prise d’indépendance progressive des territoires sud-américains va néanmoins un peu pacifier l’ambiance, en raison du progressisme relatif des créoles indépendantistes prenant peu à peu le pouvoir. C’est ainsi qu’en 1810 en Argentine, sous l’égide de Mariano Moreno, un des principaux dirigeants de la Révolution de Mai qui a conduit à la première autonomie de l’Argentine, six ans avant l’indépendance, la politique tendra davantage à l’assimilation de ces populations, plutôt qu’à leur éradication, comme il était de mise jusqu’à alors. En 1819, des accords seront même scellés avec par exemple les indiens Ranqueles, afin de constituer un front commun contre l’Espagnol (Pacte de Leuvucó). Mais à partir de 1820, les impératifs économiques vont de nouveau changer la donne.
1ères campagnes du désert : 1820–1829
En effet, la principale source de revenus pour l’Argentine indépendante, c’est le secteur agro-exportateur, porté essentiellement par l’élevage, d’où sont tirés cuirs et viandes séchées pour être exportés ensuite vers l’Europe. D’où le besoin, d’une part, de gagner toujours plus de terres agricoles, notamment en direction du sud et de la Patagonie, et d’autre part, de s’approprier les grandes salines – le sel est un ingrédient essentiel pour la conservation des viandes – qui se trouvent en territoire indigène.
C’est dans ce but qu’en 1820, le gouverneur de Buenos Aires, Martín Rodriguez, va lancer ce qui constituera la première des Campagnes du désert, qui va durer deux ans. Arrêtons-nous un peu. Oui, car cela peut paraître un brin curieux de se lancer à la conquête d’un désert, quand on cherche au contraire à trouver de bonnes terres cultivables, ou de grandes prairies. Rassurez-vous, nos vaillants militaires ne partent pas à la chasse au sable et aux cailloux. Désert n’est rien d’autre qu’une façon de parler. Et surtout, de se donner bonne conscience. En laissant penser que sur les terres en question, il n’y a pas âme qui vive. Des terres “désertes”, donc. Vides. Qui ne demandent qu’à être peuplées par de braves colons, travailleurs, bons chrétiens, parlant la bonne langue, bref : civilisés. La meilleure façon d’effacer d’un mot les premiers occupants : ils n’existent pas.
Ils existent pourtant bien la preuve : Martín Rodriguez parle de les exterminer à longueur de discours. Passons.
En 1826, Bernardino Rivadavia, premier président officiel de ce qu’on n’appelait pas encore l’Argentine mais les “Provinces-Unies”, continue le travail. Il engage un ancien officier Prussien, Friedrich (Federico) Rauch, pour poursuivre et déloger les indiens. Son action exterminatrice fera passer la superficie conquise dans la région de La Pampa de 30 000 km² à 100 000 ! L’État pourrait distribuer ces terres entre l’ensemble des agriculteurs, petits et grands, mais en réalité, il préfère privilégier les plus gros. Question de solidarité de classe. C’est ainsi que 8 600 000 nouveaux hectares de terres conquises passent aux mains de seulement 538 propriétaires terriens. Les petits paysans, eux, devront donc se contenter d’en être les locataires, ou métayers (arrendatarios). Un certain “pli” est pris : une classe dominante de grands propriétaires terriens, souvent issus de l’aristocratie ou de la grande bourgeoisie, met la main sur l’Argentine, et elle n’est pas près de la lâcher. Le drame argentin, celui d’un pays durablement dominé par une caste latifundiste, se met en place, pour très longtemps. Nous en reparlerons.
 La conquête du désert — Tableau de J.M. BLanes (détail) — Photo DP
La conquête du désert — Tableau de J.M. BLanes (détail) — Photo DP
2ème Campagne : 1833–1864
Cette campagne-là est impulsée par le gouverneur de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas (celui-là même qui va prendre le pouvoir, en dictateur de fait, pendant 17 ans entre 1835 et 1852). Rosas confie les clés de cette nouvelle “aventure” indienne au caudillo Facundo Quiroga, qui est tout sauf un tendre et un raffiné. De toute façon, tout le monde la soutient, cette campagne : les Fédéralistes de Rosas, mais également les Unitaires qui s’opposent à lui par ailleurs. On a toujours besoin de plus de terres, d’une part, et après tout, massacrer les indiens, c’est faire triompher la civilisation sur la barbarie, comme l’écrira à peu près Domingo Sarmiento, ci-devant intellectuel de la génération 37, Unitaire convaincu et futur président de la république. Cette fois, la frontière avance jusqu’au fleuve Colorado. Une centaine de kilomètres au sud de l’actuelle Bahia Blanca, aux portes de la Patagonie.
3ème campagne : 1852–1874
La Patagonie, justement. Des espaces gigantesques, et prometteurs. “Déserts”, eux aussi, naturellement. Et sur lesquels on verrait bien paitre les ovins qui représentent un lucratif commerce avec les Anglais, qui ont tant besoin de matière première laineuse pour leur industrie textile. Un haut fonctionnaire évoquera même l’opportunité de “remplacer les indiens par des brebis” (Oui, parce qu’on a beau prétendre que les espaces sont déserts, on ne peut pas s’empêcher de mentionner la nécessité de les dépeupler).
Domingo Sarmiento, dont on a parlé ci-dessus, préside l’Argentine de 1868 à 1874. Grand admirateur de la civilisation anglaise, pour lui, pas d’alternative : ou bien on impose une civilisation à l’européenne, ou bien on en reste à la barbarie. Il n’inclut pas les indiens dans son rêve d’Argentine moderne. Son successeur, Nicolás Avellaneda, est sur la même ligne, avec en plus des accointances plus serrées avec la grande bourgeoisie terrienne (à côté, Sarmiento, sorte de Jules Ferry Argentin, aurait pu passer pour un social-démocrate). Avellaneda poursuit “l’oeuvre” de Sarmiento, en lançant un vaste plan de recrutement d’immigrés européens, à travers la «Loi d’immigration et de colonisation». Une grande campagne publicitaire est lancée dans toute l’Europe : affiches et tracts promettent aux volontaires billet de bateau gratuit, et terres et travail à l’arrivée. Cela fonctionne à merveille, mais pour fournir les terres promises, il faut naturellement encore trouver de nouvelles surfaces disponibles. Une nouvelle offensive est lancée à cet effet, sous les ordres d’ Adolfo Alsina, ministre de la Guerre d’Avellaneda et ancien vice-président de Sarmiento. Cette offensive fera gagner 56 000 km² supplémentaires en direction du sud. Un dixième de la France, en superficie, quand même !

Domingo Faustino Sarmiento — Photo DP
4ème campagne : 1878–1879
C’est la plus emblématique, et probablement la plus meurtrière. Elle est menée par un militaire, Julio Argentino Roca, successeur d’Alsina au poste de ministre de la guerre. Roca en tirera un immense bénéfice de célébrité : il sera élu président de la République deux fois : la première pour succéder à Avellaneda en 1880, la seconde en 1898.
Pour cette nouvelle conquête, Roca dispose d’un budget important (1 600 000 pesos de l’époque), qui lui permet d’une part de considérablement moderniser l’armement de ses troupes, en les dotant notamment du nouveau fusil Remington, qui leur procure une capacité de feu et de portée inégalées, et d’autre part de faire installer un réseau de télégraphie améliorant les communications militaires. Le gouvernement compte sur la vente des terres nouvellement conquises pour récupérer cet investissement.
 Julio Argentino Roca — Photo DP
Julio Argentino Roca — Photo DP
L’essentiel de la campagne se déroule de mars à juin 1879, et implique un total de 6000 soldats, pour combattre environ 20 000 indiens dont Roca lui-même dira qu’ils n’avaient pour armement que “lances, arcs et flèches primitifs”. La campagne se solde par le massacre de milliers d’indiens, et la réduction des survivants en quasi esclavage, auquel bien peu survivront, entre privations et maladies apportées par les conquérants.
Au final, cette dernière campagne permettra aux gouvernements conservateurs successifs (le Parti Autonomiste National gardera le pouvoir sans discontinuer jusqu’en 1916) d’attribuer près de 42 millions d’hectares de terres à seulement 1800 propriétaires, au total, dont 6 millions à seulement 67 familles (la seule famille Martinez de Hoz en recevra pour sa part 2, 5 millions) ! S’attirant ainsi l’appui durable de la grande bourgeoisie terrienne, et renforçant le pouvoir militaire. Tout cela avec le soutien actif de l’Église catholique, qui voyait là également une œuvre missionnaire de civilisation des peuples indigènes. Un accaparement de richesses qui ne sera pas sans conséquence sur le destin politique et économique de l’Argentine, et marquera durablement les relations sociales à travers son histoire future.