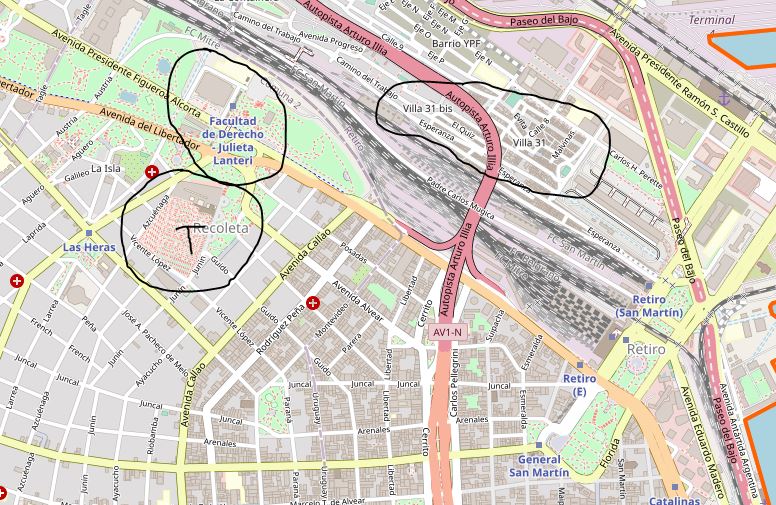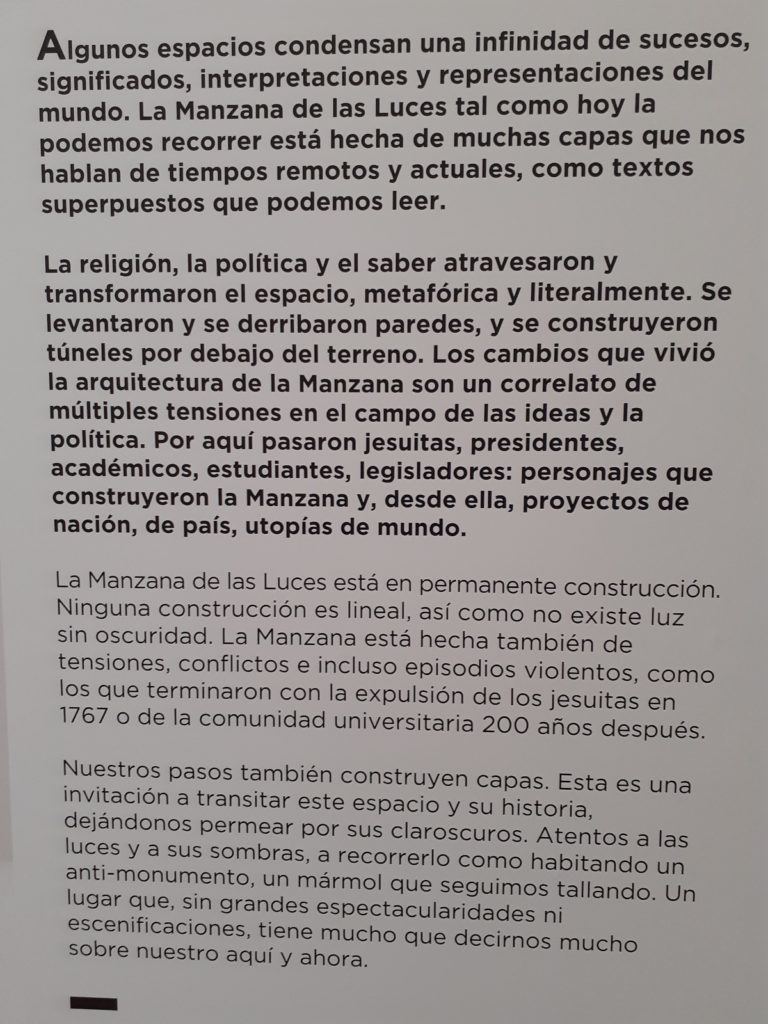Escrito el 5 de enero de 2020
Pasé la mañana de ayer en San Telmo. Me asombra lo que produce en mi mente, cada vez que lo visito, ese barrio. Desde un principio, me enamoré, como dicen en los malos documentales. Para mí representa el alma de la ciudad de Buenos Aires, el núcleo espiritual. No por casualidad: es uno de los barrios más antiguos, que conoció las grandes olas de inmigración de los años 1890–1910. En la época era un barrio tanto popular como cosmopolita, con sus conventillos (casas de dos o tres pisos cuyos departamentos minúsculos daban en una galería cercando un patio interior) donde se amontonaban los europeos que acababan de llegar en barcos, la mayoría españoles e italianos.
Antes de estas olas de inmigración, vivían acá los porteños más acomodados: San Telmo era un barrio más bien residencial. Todavía se nota Me parece que es esta doble identidad – barrio acomodado, luego barrio muy pobre – que le procura este alma especial y emblemático. San Telmo es como un concentrado de épocas y poblaciones muy distintas. Pero de todo eso no queda casi nada: ni de la primera época, ni de la segunda. Como lo que ocurrió con el barrio de Montmartre en Paris, San Telmo se volvió un museo al aire libre. Uno puede andar en sus calles (muchas guardaron sus antiguos adoquines), es difícil imaginar gente de verdad viviendo acá, por lo menos en el corazón del barrio, rectángulo formado por la avenida Belgrano, la plaza Dorrego, y las calles Piedras y Defensa. No se ven muchas tiendas tradicionales en esta zona, donde pululan las tiendas para turistas. En eso el mercado es emblemático: no se ven muchos puestos de comercio de viandas, la mayor parte del espacio estando ocupado por puestos de antigüedades y de comida rápida y barata “típica”. O sea que se destina a un público muy particular.en fachadas antiguas, aunque con el tiempo esas casas se volvieron bastante destartaladas. La epidemia de fiebre amarilla (1871) cambió del todo el universo demográfico del barrio.

Me parece que es esta doble identidad – barrio acomodado, luego barrio muy pobre – que le procura este alma especial y emblemático. San Telmo es como un concentrado de épocas y poblaciones muy distintas. Pero de todo eso no queda casi nada: ni de la primera época, ni de la segunda. Como lo que ocurrió con el barrio de Montmartre en Paris, San Telmo se volvió un museo al aire libre. Uno puede andar en sus calles (muchas guardaron sus antiguos adoquines), es difícil imaginar gente de verdad viviendo acá, por lo menos en el corazón del barrio, rectángulo formado por la avenida Belgrano, la plaza Dorrego, y las calles Piedras y Defensa. No se ven muchas tiendas tradicionales en esta zona, donde pululan las tiendas para turistas. En eso el mercado es emblemático: no se ven muchos puestos de comercio de viandas, la mayor parte del espacio estando ocupado por puestos de antigüedades y de comida rápida y barata “típica”. O sea que se destina a un público muy particular.

Ayer me dejé llevar por el instinto turístico, y me acerqué a uno de estos puestos. No tenía sillas, ni mesas, solo una barra por sus tres lados, con sillas altas. Encontré un sitio en la única que quedaba libre, y esperé a que me atendieran leyendo la carta del menú. Se trataba de un puesto de choripanes: algo parecido al perro caliente, pero en vez de la salchicha de plástico tradicional, ponen unos chorizos muy gordos. Bueno, no exactamente chorizo, quiero decir, lo que nosotros franceses solemos conocer bajo este nombre. No, acá se trata de otra salchicha, que puede ser de cerdo o de cordero. Y añaden, según el gusto del cliente, salsa, cebolla, lechuga, rúcula (a los argentinos les gusta sobremanera la rúcula) etc…
Como es de costumbre en Argentina, el cliente tiene que tener mucha paciencia. Me llevaron el vaso de vino muy rápido, pero luego tuve tiempo para tragarlo todo antes de que me llevaran el tan esperado choripán. Cabe admitir que es una garantía de calidad: asen los chorizos a medida de los pedidos. Me gustó mucho. Pero comer así solo frente a la barra, escuchando las conversaciones alrededor – y escuchar no significa entender, a lo mejor se oye un bullicio confuso – no favorece el deseo de prolongar el almuerzo. Supongo que otro turista menos tímido hubiera entablado conversación con su vecino, pero eso es algo casi imposible para mí.
San Telmo-Montmartre. Supongo que es mi apetencia para la historia que motiva mi amor por estos dos barrios, pese a que se volvieron sólo trampas para turistas. También es que, detrás de esos disfraces bastante nuevos, no es muy difícil encontrar la esencia antigua y evocar, aunque sea sólo en su mente, lo que fueron antes de volverse museos: los testigos de una gran historia popular. De todos modos, me parece imposible visitar las dos capitales sin pasar por sus calles por lo menos una vez.