On l’a vu dans l’article précédent, la loi Sáenz Peña, promulguée en 1912, en instaurant le suffrage universel (masculin) et le secret du vote, a mis fin à plusieurs décennies de fraude électorale en faveur d’un seul et unique parti, celui de l’oligarchie des propriétaires terriens, le Parti Autonomiste National (P.A.N.). Les conséquences de cette nouvelle donne ne se font pas attendre : d’autres partis se glissent dans l’entrebâillement de la porte, et trouvent des électeurs parmi, en grande partie, les fils des immigrants de la dernière génération, celle de 1880–1910.
Le principal parti d’opposition, à la fin du XIXème, c’est l’Union civique radicale. A la base, un parti de jeunes loups de la politique. Il commence par s’appeler, en 1889, « Union civique de la jeunesse » (Unión cívica de la juventud), comptant dans ses rangs outre son fondateur Francisco Barroetaveña, de futurs grands dirigeants argentins comme Juan B. Justo, qui fondera quelques années plus tard (en 1896) le premier parti socialiste argentin, et Marcelo Torcuato de Alvear, futur président de la République (1922–1928). Mais surtout, il jette des ponts avec le reste de l’opposition républicaine, et notamment l’ancien président et fondateur du grand quotidien La Nación, Bartolomé Mitre, ainsi que Leandro Alem, un ancien du Parti autonomiste en rupture de ban et fondateur du Parti Républicain.
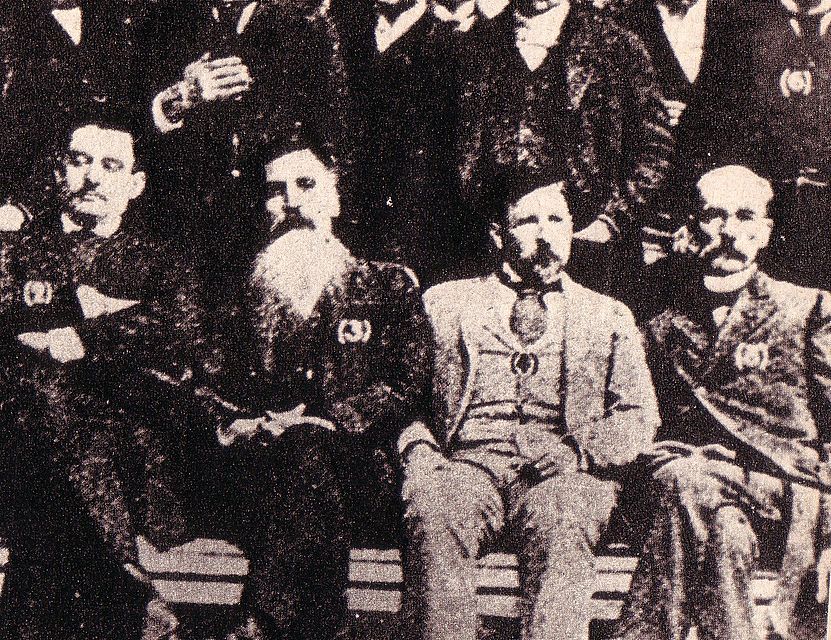
Le 13 avril 1890, nait de ces rapprochements l’Union Civique, dont Leandro Alem est élu président. En juillet de la même année, ce mouvement enclenche la Revolución del Parque, qui, si elle échoue, parvient néanmoins à faire chuter Juárez Celman, qui démissionnera au profit de son vice-président Carlos Pellegrini. Première petite victoire, mais pour le moment, le P.A.N. a encore les choses bien en mains : l’opposition reste balbutiante, et, comme souvent, minée par les dissensions et querelles d’égo. Pendant ce temps, les magouilles électorales permettent au pouvoir de se maintenir à flot, comme en 1892, deux ans après la Révolution du Parc, quand Carlos Pellegrini parvient à faire interdire à l’Union Civique (devenue Union civique radicale en 1891) de présenter un candidat à la présidentielle en inventant un pseudo complot séditieux.
Après le suicide de Leandro Alem en 1896, très affecté par les querelles internes et les défaites politiques, c’est son neveu, Hipólito Irigoyen (1852–1933), qui prend la tête du mouvement, en 1903.
La trajectoire politique du nouveau dirigeant n’a rien de révolutionnaire. Fils d’un immigré basque français et de la sœur de Leandro Alem, il a d’abord grossit avec son oncle les rangs du P.A.N. Il n’avait alors que 17 ans. Sept ans plus tard, toujours avec son oncle, il fait partie des fondateurs du nouveau Parti Républicain, et à 25 ans, il devient député. C’est que c’est un jeune homme très actif. A partir de 1880, il officie en tant que professeur d’histoire à l’École normale d’instituteurs, en 1881, il obtient son diplôme d’avocat, et parallèlement à tout ça, il trouve encore le temps d’acheter des terres agricoles et de devenir propriétaire de plusieurs «estancias» (ranch, en bon français) où il pratique l’élevage à viande. Après la Révolution du Parc, il rejoint les rangs du nouveau parti dirigé par son oncle Leandro Alem, l’Union Civique radicale, et participe à une seconde tentative révolutionnaire, en 1893, aux côtés de Marcelo Torcuato de Alvear. Nouvel échec, qui lui vaudra arrestation et bref exil en Uruguay.
Troisième essai en février 1905, un soulèvement armé dans cinq grandes villes simultanément (Buenos Aires, Bahia Blanca, Mendoza, Córdoba et Santa Fe), soulèvement qui ira jusqu’à la séquestration du vice-président Figueroa Alcorta, mais qui, faute de soutien populaire et militaire, et après la proclamation de l’état de siège, se terminera par une nouvelle défaite. Un coup de boutoir qui cette fois encore ne sera pas parvenu à abattre le mur conservateur, mais qui néanmoins l’aura sérieusement fissuré. En effet, à partir de ce moment, plus rien ne sera comme avant au P.A.N., qui commence à se fractionner. C’est que certains commencent à sentir que le vent est en train de tourner, et que le bon vieux système est à bout de souffle. Cette nouvelle tendance, emmenée par Roque Sáenz Peña, finit d’ailleurs par l’emporter, et fait faire un dernier tour de piste à ce qu’il reste du P.A.N. en 1910. Le temps de promulguer la fameuse loi sur le suffrage universel et secret. Qui permettra enfin à l’opposition de prendre son tour : aux élections de 1916, c’est donc le candidat de l’Union civique radicale, Hipólito Irigoyen, qui est élu.
Autant dire que s’est un sacré coup de tonnerre, après presque trente ans de conservatisme. Bon, ne nous emballons pas trop non plus, ce n’est pas vraiment la révolution qui triomphe avec Irigoyen. On l’a vu, l’homme n’est pas issu des bas-fonds de la société argentine, c’est un avocat doublé d’un confortable propriétaire terrien, ce n’est donc pas encore tout à fait le peuple qui arrive au pouvoir. Mais cette élection, qui met dehors, à la régulière, le vieux parti de la classe dominante, est quand même une sacrée victoire pour tous ceux qui jusque là, avaient été totalement exclus de la vie politique nationale. Car comme le rappelle l’historien Raúl Scalabrini Ortiz (« Irigoyen y Perón », Ed. Fabro, p.15) « Pendant 63 ans, de 1853 à 1916, l’oligarchie a gouverné le pays sans plus de contraintes que le choc des ambitions et de la cupidité de ses membres. Le gouvernement sortant choisissait le gouvernement suivant. Le peuple n’était rien d’autre qu’un producteur de richesses au bénéfice d’une autre partie de la société. Le pays n’avançait qu’à la mesure des désirs de l’Etranger et de son médiateur national ». Cette fois, le peuple avait donc pu choisir lui-même son destin : on comprend alors que l’avènement d’Irigoyen ait pu être vécu comme une réelle victoire populaire. Raúl Scalabrini, toujours (p.16) : « Revendiquer les droits du peuple, respecter sa volonté, équivalait à révolutionner l’ordre du régime. Celui qui incarnait la représentation légitime du peuple ne pouvait qu’être révolutionnaire au sens le plus complet du terme ». Et puis, ne pas oublier qu’Irigoyen avait participé à rien moins que trois révolutions destinées à renverser le régime conservateur. En somme, il devient naturellement le premier héros populaire de la politique argentine. Un « pré-Perón », en quelque sorte. On le verra plus tard, lorsqu’il sera lui-même confronté à la colère du peuple, lors de la « Semaine tragique » en 1919 et des grèves d’ouvriers agricoles en Patagonie en 1921, sa réaction le sera nettement moins, populaire. Mais il restera à jamais comme le premier président réellement élu au suffrage universel et non truqué de l’histoire argentine.

